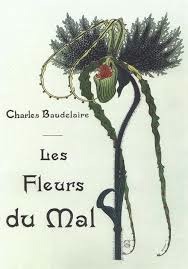Poésie Française

App for iPad...
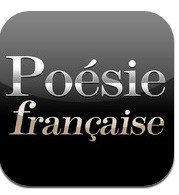
L'anthologie de Georges Pompidou
Sur tout ce qui précède le XVe siècle, je ne dirai rien, n'ayant pas cru pouvoir faire figurer valablement dans cette anthologie la poésie du Moyen Age. Même Rutebeuf qui, par tant de traits, préfigure François Villon, reste, pour le lecteur non préparé, la plupart du temps incompréhensible. Eustache Deschamps se lit plus facilement. Habile versificateur, il est souvent poète vrai.
Le XVe siècle est un siècle triste. Comme toutes les civilisations à leur déclin, le Moyen Age s'attarde désespérément à ce qui fit sa grandeur ou son charme, et qui va mourir. De l'homme du Moyen Age, la poésie nous fournit deux types d'exemplaires, Charles d'Orléans d'abord, vrai chevalier de notre littérature et maître souverain dans toutes les formes de littérature propres à son temps. Qu'il exprime simplement des sentiments simples - amour de la patrie, de la paix, de la femme -, qu'il utilise au contraire toutes les subtilités et les obscurités de l'allégorie, il apparaît comme une âme noble et sensible s'épanchant dans des vers pleins de musique et de clair-obscur. C'est un grand poète, le premier d'une illustre lignée, celle de Joachim Du Bellay, Gérard de Nerval et de Guillaume Apollinaire.
Si Charles d'Orléans a toutes les grâces du Moyen Age, Villon en incarne les angoisses et les remords. Plus qu'une banale préfiguration des poètes maudits, cet étudiant bourgeois devenu bandit exprime la grande terreur du monde médiéval en proie à la misère et à la maladie, angoissé par la mort et l'au-delà, réconforté par les plaisirs élémentaires de la table et du lit et, parfois, par l'espérance. Il a peu écrit et encore y a-t-il dans son oeuvre beaucoup de vers inutiles. Mais les quelques centaines de vers qui comptent suffisent à faire de lui l'un des grands parmi les grands, avant et avec Charles Baudelaire, celui qui a su le mieux parler de la mort.
C'est un malheur pour Clément Marot d'ouvrir le XVIe siècle en succédant à François Villon. Il avait pourtant beaucoup des vertus qui s'épanouissent chez Jean de La Fontaine. Mais dans ses épîtres par exemple, si remarquables à tant d'égards, fait défaut ce quelque chose qui, précisément, est la poésie. Pourtant, il n'en manquait pas et il l'a semée sans parcimonie dans de nombreux petits poèmes qui suffisent à le mettre en bonne place parmi nos poètes mineurs, qui ne sont pas les moins charmants.
On fait grand cas, depuis quelque trente ans, de l'école lyonnaise. Maurice Scève, Louise Labé, Pernette du Guillet ont été exhumés et solennellement conduits au Panthéon. A vrai dire, Fourvières aurait suffi. Maurice Scève est doué, et ses débuts, en particulier, sont souvent éclatants. Mais le souffle poétique lui manque. Il cherche à y suppléer par la recherche formelle et l'obscurité précieuse, qui lui ont valu de nos jours d'enthousiastes admirateurs. Mais je ne connais rien de plus fastidieux que du Scève à haute dose. La répétition des procédés, le déroulement sans fin de vers où la platitude alterne avec la fermeté gâchent l'oeuvre de ce vrai poète à qui il a manqué de se résigner à peu produire pour être l'égal des grands.
Louise Labé a moins de mérites. Mais certains de ses sonnets ont de l'élan et elle a parfois de vrais bonheurs d'expression. Je la préfère et de beaucoup à l'insipide Pernette du Guillet.
L'école lyonnaise garde cependant un style provincial au regard de la fourmillante capitale de la Poésie : voici la Pléiade avec Pierre de Ronsard et Joachim Du Bellay suivis d'une foule de disciples dont quelques-uns furent presque des maîtres. Ici plus qu'ailleurs, devant une telle abondance, j'ai dû choisir. Au demeurant, Jean Dorat, Remy Belleau, Pontus de Tyard, Jodelle ne sont que des images affadies de Ronsard, et les efforts de Jean-Antoine de Baïf ou de Guillaume de Salluste Du Bartas pour trouver leur propre originalité me paraissent avoir été frappés d'insuccès. J'ai donc préféré m'en tenir à Pierre de Ronsard et Joachim Du Bellay, puis, parmi les successeurs, à Philippe Desportes, qui me paraissent dominer largement leurs émules.
Ronsard, bien sûr, est le plus grand. Le meilleur de lui-même se trouve, j'en suis convaincu, dans les Amours ou dans les poèmes où il a chanté son pays natal, non dans les Hymnes et les Discours où de surprenantes beautés ne se découvrent qu'avec effort au sein de développements interminables et parfois grandiloquents. Le "faste pédantesque" de Nicolas Boileau n'était pas entièrement immérité !
Joachim Du Bellay est plus limité. Il est pourtant la poésie même et doit être cher à notre coeur. Les sonnets de l'Olive, des Antiquités de Rome, des Regrets, sont d'une facile et souveraine beauté et l'élégance de l'âme y trouve son expression naturelle. Ils ne sont pas cependant toute l'oeuvre de Du Bellay et certains poèmes comme la Complainte du désespéré ont un accent surprenant. Desportes n'est pas un successeur indigne et les textes que je cite suffiront, je l'espère, à donner une idée de la variété d'inspiration et de ton d'une oeuvre considérable et mal connue.
Si Philippe Desportes se rattache à Ronsard, Théodore Agrippa d'Aubigné est un isolé. Tourmenté dans son style comme dans ses passions, parfois boursouflé, à d'autres moments d'une pureté toute classique, il évoque ces églises de style jésuite où le baroque se mêle à l'antique. Mais il est habité par le génie et a écrit quelques-uns des plus beaux vers de notre langue. Son Jugement dernier a les vertus (et les défauts) de celui de Michel-Ange. L'Hiver, malgré des faiblesses, est un merveilleux poème.
Avec François de Malherbe, nous tournons une page. Moins à cause de son oeuvre que de son influence. Comme poète, Malherbe n'est pas tellement loin d'Agrippa d'Aubigné : il a beaucoup moins "le don", mais lorsqu'il est inspiré, il écrit, lui aussi, de très beaux vers. Entre-temps, il révèle un même goût de rhétorique et de la boursouflure, mais qu'il plie aux lois d'une syntaxe et d'une rythmique rigoureuses. Par là, il justifie le rôle que lui attribue Boileau. Il stérilise l'élan lyrique du XVIe siècle et ce qui en subsiste après lui fait figure de parent pauvre et a quelque chose d'inachevé. Il oriente nos écrivains vers les règles étroites sous lesquelles la poésie française finira par succomber momentanément, mais non sans avoir produit quelques-uns de ses meilleurs chefs-d'oeuvre.
A côté de Malherbe, un adversaire, Mathurin Régnier, plein de verve et de talent : mais la poésie satirique n'est pas notre objet. De Jean de Sponde, versificateur consciencieux et qui n'est pas toujours dénué de poésie, je donne un sonnet. François Maynard est un sous-Du Bellay corrigé par Malherbe mais il a écrit quelques vers harmonieux et d'un ton déjà moderne. D'Honorat de Bueil, seigneur de Racan, je n'ai pas cru pouvoir me dispenser de citer les fameuses Stances, où la strophe de Malherbe habille convenablement une philosophie banale : c'est du bon "prêt à porter".
Il en est tout autrement de ces poètes du début du XVIIe siècle que Boileau a rejetés dans l'ombre, ou plus exactement dans une sorte d'opposition stérile à la royale poétique de nos grands classiques. Théophile de Viau, Marc-Antoine Girard de Saint-Amant, François Tristan l'Hermite sont non seulement des figures attachantes mais des êtres pleins de dons. Ils se détachent d'un groupe compact de "grotesques" (Paul Scarron) ou de "précieux" (Vincent Voiture, Isaac de Benserade, Cotin) qui, après trois siècles, ne se sont pas relevés des assauts convergents de Boileau et de Molière. A dire vrai, cet oubli n'est pas inexplicable. Aucun de ceux que je nomme n'a réussi vraiment à réaliser une oeuvre. Observons d'ailleurs ceci : à chaque époque, tous les poètes traitent les mêmes sujets. Or, tandis que lorsqu'on a cité un poème de Ronsard, il apparaît vain de citer les vers écrits sur le même thème par Rémy Belleau ou Jean-Antoine de Baïf, qui ne sont que des satellites, il est presque impossible de faire un choix entre les poèmes que Théophile de Viau, Marc-Antoine Girard de Saint-Amant et François Tristan l'Hermite consacrent au même sujet.
Tous trois ont des vertus, quelques strophes charmantes, un accent particulier : plus d'imagination et de verve chez Saint-Amant, plus de poésie naturelle chez Théophile de Viau (le plus doué des trois à mon sens), plus de recherche et de trouvailles chez Tristan l'Hermite. Aucun des trois n'échappe à la prolixité, ni même à une certaine platitude dans la préciosité. Il faut donc les citer tous trois. Il y a de la poésie chez ces écrivains qui font la preuve qu'il est difficile de nager à contre-courant et de devenir, avec des dons naturels éminents, un très grand poète lyrique lorsque toute votre époque tourne le dos au lyrisme.
De Voiture, je cite un sonnet, sans mérite éclatant, mais qui donne une idée de ce que fut la poésie précieuse : elle a beaucoup de défauts mais au moins n'est pas vulgaire. Son chef d'oeuvre est peut-être, par l'ironie du sort et du talent, le sonnet que Molière a écrit pour s'en moquer dans Le Misanthrope.
Est-ce à dire que la poésie soit, au XVIIe siècle, réservée aux "égarés" ou aux "attardés" ? Assurément non. Notre littérature classique s'éloigne il est vrai du lyrisme pur, mais non de la poésie. La liaison d'ailleurs est faite par Jean de la Fontaine, l'esprit le plus libre, le plus fantaisiste, le plus individualiste qui soit, mais aussi l'artiste le plus scrupuleux, le plus soucieux de la forme, maître dans l'art classique de "faire difficilement des vers faciles". Ne nous donnons pas pas le ridicule d'essayer de définir La Fontaine : simplement c'est dans les Fables qu'il faut le chercher. J'ai choisi presque exclusivement des fables où la poésie prend le pas sur l'anecdote, l'esprit, la réflexion morale ou, en tout cas, s'y mêle constamment. Avant et après La Fontaine, voici Pierre Corneille, Molière, Boileau.
Corneille est poète. Pour le montrer, je n'ai pas eu recours à telle ou telle paraphrase de psaumes. Depuis Marot et Malherbe en passant par Pierre Corneille, Jean Racine et bien d'autres, il s'est créé un genre assez conventionnel auquel s'adonnent les poètes, surtout dans la dernière partie de leur vie, et qui conduit tout droit à la rhétorique rythmée de Jean-Baptiste Rousseau et de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Malgré quelques vers de qualité, notamment chez Racine, rien ne condamnerait davantage la poésie française que ces pieux exercices de style si elle ne devait être cherchée ailleurs. Chez Corneille, à quelques heureuses exceptions près, la poésie est avant tout dans ses tragédies, y compris dans les dernières. J'ai pourtant limité mon choix à Cinna et Polyeucte, et surtout au Cid dont je donne la grande scène entre Rodrigue et Chimène. Malgré son caractère fatalement dramatique, malgré une certaine tendance des personnages cornéliens à la plaidoirie presque chicanière, cette scène reste essentiellement un admirable chant d'amour. Elle fait partie de la poésie universelle aussi bien que les duos de Roméo et Juliette.
Les noms de Molière et Boileau ne pouvaient être absents, bien que l'objet même de leur art ait écarté ces maîtres du vers de ce qui est proprement poésie. Après eux, Racine, le plus grand poète français du XVIIe siècle avec La Fontaine et l'un des plus grands de notre histoire. J'ai puisé largement dans ses tragédies, où la poésie est constamment présente parce que, s'il est aussi dramatique que Corneille, il n'est oratoire qu'exceptionnellement et malgré lui : poésie liée sans doute aux situations dramatiques - comme dans Bérénice - au caractère du rôle - telle la pudeur de Monime - à l'atmosphère légendaire de la mythologie - récit de Mithridate - et j'aurais pu citer aussi le grand récit d'Agrippine, mais parfois poésie lyrique presque pure : je pense à Clytemnestre évoquant son retour après le sacrifice d'Iphigénie : Et moi, qui l'amenai triomphante, adorée, Je m'en retournerai, seule, et désespérée ? Je verrai les chemins encor tout parfumés Des fleurs dont sous ses pas on les avait semés ? ou encore au récit d'Ulysse à la fin de la même pièce : Les vents agitent l'air d'heureux frémissements Et la mer lui répond par ses mugissements. La rive au loin gémit, blanchissante d'écume...
On pourrait ici multiplier les citations. Sauf dans les "intervalles", quand il lui faut expliquer les allées et venues de ses personnages ou les péripéties secondaires de l'action, Racine est constamment poète. Pour lui, comme pour La Fontaine ou Baudelaire, une anthologie ne peut être qu'une amputation. Ayant porté jusqu'à la perfection la poésie la plus naturelle et la plus raffinée à la fois, il a cependant contribué à tarir la source de notre poésie. Pendant plus d'un siècle, il n'aura que des imitateurs.
Le XVIIIe siècle, faute d'avoir pu secouer les influences et renouveler son inspiration, fait figure de désert poétique. Voltaire, habile versificateur, est la plupart du temps sans âme. Si quelques auteurs, pour qui l'art des vers ne présentait pas de difficultés, méritent d'être cités, c'est pour les rares oeuvres où commence à se dessiner l'évolution vers le lyrisme personnel. Ainsi peut-on réserver une petite place à Jean-Baptiste Rousseau, Jacques Delille, Nicolas Gilbert. Mais ce n'est qu'avec les romantiques que cette forme poétique connaîtra son éclat.
La fin du XVIIIe siècle voit cependant surgir quelqu'un qui, s'il avait vécu, aurait peut-être modifié cette évolution. André Chénier essaie de créer une poésie personnelle de tradition classique, solidement appuyée sur la culture grecque et qui, dans le lyrisme, se rattache à l'influence racinienne, mais en la renouvelant. Il est mort trop tôt pour s'accomplir. Beaucoup de ses Bucoliques gardent encore un côté "exercice de style" ou "prix de Rome". Il a, dans ses Elégies, des débuts admirables, qui parfois tournent court, ses longs essais comme l'Amérique ne se distinguent qu'exceptionnellement du didactisme de Delille et ses derniers poèmes, les plus émouvants, restent encore un peu oratoires. Mais c'est un vrai poète qui avait en lui la certitude d'une grande oeuvre et qui aurait pu épargner à notre XIXe siècle romantique un certain nombre de défauts irritants.
De ce XIXe siècle, le premier représentant notable est Alphonse de Lamartine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas à la mode. Il est d'ailleurs facile à critiquer. Il a écrit un grand nombre de poèmes que Charles-Hubert Millevoye ou Jean-François Ducis pourrait revendiquer. Rien de plus ennuyeux que la Chute d'un ange si ce n'est Jocelyn. Mais les grandes Méditations sont parmi les chefs-d'oeuvre de notre poésie : on peut préférer l'ivresse d'alcools plus secs, mais non, selon moi, être insensible à l'Isolement, au Vallon ou au Lac. Chaque fois qu'il a été inspiré par un sentiment fort, Lamartine a trouvé des accents d'une rare beauté. Quand aujourd'hui nous le relisons, que nous recherchons tout ce qui le rattache encore à Delille et à Millevoye, que nous le comparons à ceux qui l'ont suivi, et surtout à Baudelaire et aux symbolistes, nous finissons par oublier son rôle capital : on peut regretter que Chénier n'ait pas été là pour le jouer à sa place. Mais il est de fait que Lamartine a ramené la poésie en France et a été l'initiateur du siècle lyrique le plus riche de notre histoire.
Après lui, voici, en foule, des noms de premier plan. Et d'abord, Victor Hugo. "Hugo, hélas !" disait André Gide. Assurément, la poésie de Hugo n'est pas celle qui me touche le plus. La facilité verbale des premiers recueils irrite et plus encore peut-être le prétentieux délire des derniers. On a voulu faire de la Fin de Satan, de Dieu, les sommets de son oeuvre. Si c'est par réaction contre l'Enfant grec ou contre "Donne-lui tout de même à boire, dit mon père", je veux bien. Mais, plus encore que dans les Tragiques d'Agrippa d'Aubigné, pour un vers éclatant, que de phraséologie ! Je ne rappelle que pour mémoire les lourdes facéties des Chansons des rues et des bois. Au milieu de tout cela, beaucoup de beaux vers, quelques chefs-d'oeuvre admirables. Mais rien ne vaut la suite des recueils : les Feuilles d'automne, les Chants du crépuscule, les Voix intérieures, les Rayons et les Ombres, les Châtiments, les Contemplations, la Légende des siècles. C'est là que ce prodigieux génie, bouillonnant d'images et de visions, transfigurant l'histoire, celle du monde et la sienne propre, accumule par milliers d'admirables vers.
Hugo domine le siècle. Tous ceux qui ont écrit des vers entre 1830 et 1880 ont pensé à lui, ont cherché à s'arracher à son influence, ont désespéré d'exister auprès de ce géant. Et pourtant, ou peut-être à cause même de cette rivalité, nous trouvons là plusieurs de nos meilleurs et de nos plus grands poètes.
En premier lieu, Alfred de Vigny. Figure particulièrement attachante, parce qu'il est un de ces poètes que la grâce ne touche que par moments, mais avec quel éclat ! Beaucoup de ses oeuvres sont médiocres et, dans les meilleures, il n'évite pas toujours le mauvais goût ou la platitude. Parmi ses réussites Moïse, le Mont des Oliviers, la Mort du loup gardent encore une certaine froideur compassée. Mais la Colère de Samson et la Maison du Berger renferment quelques-uns des plus beaux vers qui soient et ont une allure, un style qui les placent au premier rang.
Gérard de Nerval, lui aussi, écrit en vers difficilement. Mais ses poèmes sont presque tous des chefs-d'oeuvre d'une extrême densité. Lorsque Gide déclare qu'il a fait "de vains efforts pour s'éprendre de Gérard de Nerval", cet aveu me paraît se retourner contre son auteur. Non seulement Gérard de Nerval est poète, mais recherchant systématiquement les vertus d'incantation de l'obscurité et du symbole, réussissant là où Scève avait échoué, il ouvre à la poésie française une voie dans laquelle depuis Malherbe elle avait refusé de s'engager et, secouant le joug de Hugo, par-delà ses contemporains, prépare Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé et Arthur Rimbaud.
Avec Alfred de Musset, nous sommes dans un tout autre univers. Autant Alfred de Vigny et Gérard de Nerval peinent devant "le vide papier que la blancheur défend", autant Musset a de facilité. Son oeuvre s'en ressent, bien sûr. Mais il a si évidemment le don de poésie, il est si loin de toute vulgarité, qu'il fait l'effet de ces enfants terribles et charmants à qui l'on pardonne tout. Il est, dans notre littérature, le seul qui ait su mettre de la poésie dans des genres où Mathurin Régnier, Boileau, Voltaire n'ont su mettre que de l'esprit ou de la raison. Par là, il est proche de La Fontaine, qu'il aimait. Il reste enfin, par les Nuits et par quelques autres poèmes, le poète d'amour le plus vrai, le plus accessible à tous. Ce n'est pas forcément un défaut, quoi qu'en pensent certains, qui me diraient avec le Bloch de Proust : "Défie-toi de ta dilection assez basse pour le sieur de Musset. C'est un coco des plus malfaisants." Le jour où l'amour dans nos moeurs supplantera l'érotisme, Musset redeviendra à la mode. Je ne parle que pour mémoire des charmantes chansons auxquelles même de bons esprits ont cru un peu naïvement pouvoir réduire une oeuvre qui se situe immédiatement derrière les premiers plan.
Les historiens de notre littérature nous expliquent qu'après le Romantisme vient le Parnasse. Cette école, si on lui enlève les premiers vers de Paul Verlaine et de Stéphane Mallarmé, comprend un précurseur, Théophile Gautier, et un groupe abondant de poètes : Charles Leconte de Lisle, Théodore de Banville, René-François Sully Prudhomme, José Maria de Heredia, etc... Cet aveu me condamnera-t-il à mon tour ? Il y a là tout ce qui m'ennuie. Faisons une exception pour Leconte de Lisle. On trouve une vraie grandeur chez ce poète laborieux. Mais si j'ai cru devoir citer quelques vers de Gautier, c'est vraiment par respect pour Baudelaire qui lui dédia Les Fleurs du mal. Théodore de Banville, plus doué, reste creux. Heredia est un bon ouvrier du faubourg Saint-Antoine : il fait de l'ancien solide et consciencieux. Sully Prudhomme, de tous, m'attriste le plus, qui voudrait tant être poète. J'en ai pourtant cité un court poème ["Les yeux"] dans lequel les pires platitudes n'altèrent pas complètement un certain charme mélancolique.
Que tout cela paraît pâle à côté de leur contemporain, Baudelaire. Ce n'est jamais sans émotion qu'il m'arrive de regarder ce petit volume à couverture jaunâtre, paru en 1857 et qui s'intitule Les Fleurs du mal. Là est, de toute poésie, ce qui me touche le plus. L'angoisse devant la vie et devant la mort, le sentiment de la faute et celui de la révolte, la poésie de la vie moderne et celle de l'évasion trouvent chez Baudelaire leur expression la plus émouvante. A vrai dire, il est impossible de résumer en quelques mots une oeuvre où il y a tout et qu'il faut connaître en totalité. J'en ai donné ce qui me paraît le plus beau - mais, en relisant le reste, il n'est rien qui ne me paraisse digne d'être cité. Fait curieux à noter : tandis que La Fontaine reste sans postérité, que Racine stérilise la sienne, que Hugo n'engendre que de médiocres disciples, Baudelaire a suscité une école où l'on trouve de très grands poètes. C'est qu'il n'était pas un aboutissement mais un commencement. Partis de lui, beaucoup ont su se dégager de l'imitation pour trouver dans des voies diverses leur propre originalité.
Mallarmé d'abord, le plus grand peut-être. Aucun cependant n'a écrit avec tant de difficulté. Mais il a trouvé dans cette difficulté même le renouveau. La recherche dans le vocabulaire comme dans la syntaxe, l'obscurité voulue mais jamais gratuite ni vaine créent intensément le mystère de l'incantation poétique. C'est peut-être dans les poèmes plus ambitieux - Hériodade, l'Après-midi d'un faune - qu'on peut déceler les faiblesses d'une inspiration peu généreuse. Mais l'ensemble de l'oeuvre en fait un poète du premier rang et l'un de ceux qu'on peut relire sans cesse.
Verlaine est plus facile. Ne cherchons pas chez lui la puissance de la forme ou de l'imagination : il s'accompagne de la guitare ou du violon, mais s'essoufflerait à suivre un orchestre. Il n'est pas jusqu'aux célèbres sonnets chrétiens de Sagesse qui ne me paraissent d'une qualité inférieure. Mais comme Villon et Baudelaire sont les poètes de l'angoisse et du remords, Verlaine est celui de la mélancolie et du regret. Il a su en donner l'expression la plus musicale, la plus tendrement mystérieuse. Il est un des poètes les plus chers à notre coeur. Je dirais cependant qu'il a été un mauvais maître, s'il n'y avait pas Guillaume Apollinaire.
Tristan Corbière avait un vrai talent. Il est mort trop jeune pour pouvoir donner sa mesure. Je cite de lui deux poèmes où il commençait à s'exprimer, notamment l'émouvante Rapsode foraine. Dans des vers connus, il a raillé les poètes maudits dont il reste cependant le plus tragique exemple. Aurait-il réussi à se dégager de l'amertume et du grincement ? Je le crois. Mais il est difficile de faire oeuvre poétique après tant d'autres et le renouvellement, en art, est rare.
Arthur Rimbaud pourtant a fait ce miracle. Lui aussi est mort jeune, surtout à la poésie. Plusieurs de ses poèmes ne sont que les brillants exercices d'une jeunesse dorée. D'autres, à travers un effort d'originalité parfois enfantin, contiennent de grandes beautés. Certains enfin et surtout le Bateau ivre sont, malgré quelques bavures, parmi les plus authentiques chefs-d'oeuvre de notre poésie. Rimbaud, par son destin d'étoile filante comme par les quelques traces qu'il a laissées dans le ciel, continuera longtemps de faire rêver.
Peut-être me reprochera-t-on le peu de place que j'ai donné aux poètes si nombreux de la fin du XIXe siècle que mes prédécesseurs ont cités largement. Pourtant aucun de ceux que j'ai ignorés - Louis Ménard, Charles Cros, Germain Nouveau, Albert Samain, Charles Van Lerberghe et plus tard Emmanuel Signoret ou Charles Guérin - ne me semble mériter plus que la mention de son nom. Le meilleur de leur oeuvre n'est qu'un écho des maîtres du Parnasse ou du Symbolisme. J'ai cherché dans l'oeuvre abondante et estimable d'Emile Verhaeren un vrai poème. Ai-je réussi ? On peut être plus généreux pour Jean Moréas dont les Stances ont souvent du ton. Henri de Régnier a écrit quelques jolis vers. Jules Laforgue était infiniment plus doué. Mais il est bien rare qu'il arrive à dominer le vain désir de choquer et il y a dans son oeuvre grimaçante beaucoup de la nostalgie d'un génie qui n'a pas su éclore.
A ces poètes victimes soit d'avoir voulu viser trop haut, soit de n'avoir pas su créer leur propre originalité, je préfère le charme moins facile qu'il n'y paraît de Paul-Jean Toulet. Il était né pour d'autres époques, pour être troubadour ou pour la chambre bleue d'une jeune marquise de Rambouillet. Il n'a écrit que de menus poèmes, mais a réussi l'exploit de réconcilier le scepticisme avec la poésie. Il est à cet égard doublement une exception, à l'aube d'une époque - le début du XXe siècle - où l'on va se prendre au sérieux plus que jamais. Et pourtant cette génération va une fois encore renouveler la poésie française. A quelques années d'intervalle naissent Paul Claudel, Francis Jammes, Paul Valéry, Charles Péguy.
Paul Claudel rompt résolument avec toutes les formes de notre tradition poétique. Il remplace le vers par la phrase mesurée et rythmée et supprime, bien sûr, la rime tout en gardant à l'occasion des effets d'assonance. Pour le reste, c'est une sorte d'auberge espagnole du XVIe siècle, pleine de confusion et de vacarme, où défile la terre entière : voyageurs avec leurs souvenirs, passants avec leur passions, l'évêque et le mendiant, le roi et la sainte. Sa poésie fondamentalement dialoguée (voyez déjà la Cantate à trois voix) devait tout naturellement aboutir au drame. C'est pourquoi, à côté d'extraits des recueils poétiques, j'ai cité une scène du Soulier de satin. Génie inégal et qui ignore jusqu'à l'existence de la mesure, Claudel entraîne tout par la puissance de son souffle et de son verbe.
Le même effet de masse est recherché par Charles Péguy. Mais contrairement à Claudel, il accepte souvent les règles de la versification classique et ne cherche pas à emporter le lecteur dans le torrent de son imagination. C'est la répétition qui est moyen propre, procédé ancien et que nous retrouvons dans le refrain des chansons et des ballades, dans les variations musicales et plus encore dans les litanies d'Eglise. Gide a raison de trouver que Péguy en a abusé au point d'être illisible dans sa totalité. Mais contrairement à ce que pensait Gide, il est facile d'isoler des passages admirables, où l'effet de répétition garde toute sa vertu. Et puis, bien sûr, ce n'est pas avec les bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature. Mais la qualité de l'âme est indispensable au poète : celle de Péguy transparaît constamment et illumine une oeuvre dont le ton est authentiquement celui de la poésie.
Francis Jammes ? Une fois encore passons aux aveux. Je n'ai pas cru pouvoir l'éliminer mais jamais je n'ai pris intérêt à son oeuvre. Son ton bonhomme et paysan ne dissimulerait pas la pire médiocrité s'il s'était avisé d'écrire le vers classique. C'était un malin. Un mauvais peintre qui marche sur les pas de Raphaël ou d'Ingres se trahit aussitôt. S'il fait de l'abstrait, il faut plus d'attention pour le confondre. Ainsi Jammes, en rompant le rythme de l'alexandrin, en supprimant le plus souvent la rime, a réussi à dissimuler sa parenté avec Dupont : "J'ai deux grands boeufs dans mon étable, Deux grands boeufs blancs marqués de roux". Mais en vérité, n'est pas Virgile qui veut !
De tous trois - Claudel, Péguy, Jammes - Valéry se sépare totalement : pas d'esprit plus critique, pas d'écrivain plus rigoureux. Il ne croit qu'à un art patiemment et intelligemment élaboré. Il ordonne et dose les mots comme d'autres les chiffres ou les corps chimiques. Il arrive qu'il manque son but et que le produit ressemble à une potion pharmaceutique. Le plus souvent, l'intelligence aiguë, le sens profond de la langue, l'impeccable technique et, finalement, le don de poésie, lui ont permis d'écrire des vers qui sont parmi les plus denses de notre littérature : il ne lui a manqué qu'un peu de mystère (qui n'est pas l'obscurité) pour égaler son maître Mallarmé.
C'est à Verlaine que se rattache Guillaume Apollinaire. Il pratique lui aussi la musique de chambre et le mode mineur. Quand il cherche à en sortir, cela lui réussit médiocrement et ses efforts pour s'échapper des sentiers battus le conduisent le plus souvent à des jongleries qui restent expérimentales. Mais dans son registre propre, il est incomparable. Tel le compagnon voulant devenir maître, il a réussi, avec la Romance du mal-aimé, son "chef-d'oeuvre", comme Rimbaud avec le Bateau ivre, ou Valéry avec le Cimetière marin. Mais la presque totalité des poèmes d'Alcools et bon nombre d'autres font un ensemble qui mettent Apollinaire parmi nos grands poètes.
Arrêtons-nous là. Il faudrait maintenant parler des contemporains et notamment des Surréalistes. Mais ayant par principe éliminé les vivants, le choix est limité. La plupart des poètes disparus depuis trente ans [l'ouvrage de G. Pompidou a été édité en 1961] me semblent de second ordre. Ni Catherine Pozzi, ni Paul Fort, ni Anna de Noailles, ni - malgré des dons plus certains mais indéfiniment gaspillés - Max Jacob, ni Pierre Reverdy ne me paraissent devoir résister à l'épreuve du temps. Pour beaucoup d'autres la poésie a été un exercice de jeunesse auquel ils ont renoncé pour des genres différents. Le cas d'Antonin Artaud m'a retenu plus longtemps : on se sent coupable de lui refuser "cette existence même avortée" qu'il demandait à Jacques Rivière pour une oeuvre si tragiquement restée au-dessous de son auteur.
En définitive, je n'ai retenu que deux noms : Jules Supervielle, un peu parce qu'il est le dernier disparu et qu'il a du charme, bien que lui manque l'essentiel. Et surtout Paul Eluard, vrai poète qu'on ose l'affirmer de quelqu'un dont la poésie est mêlée si intimement à notre jeunesse qu'on ne sait si ce n'est pas sur elle que l'on s'attendrit. Pourtant, et bien qu'il me semble qu'Eluard n'ait pas réussi tout à fait à trouver l'accent inimitable qui caractérise les plus grands, je crois qu'un peu comme Péguy cette âme noble et fière a su s'exprimer en des vers qui ne sont pas indignes des poètes dont il clôt, ici, le long cortège.
Poètes classiques
Moyen Âge
Chartier Alain - Comtesse de Die - Deschamps Eustache - Froissart Jean - Machaut Guillaume de - Marie de France - Molinet Jean - Orléans Charles d' - Pisan Christine de - Rutebeuf - Villon
16ème siècle
Aubigné Théodore Agrippa d' - Baïf Jean-Antoine de - Belleau Remy - Davy du Perron Jacques - Desportes Philippe - Dorat Jean - Du Bartas Guillaume de Salluste - Du Bellay Joachim - Garnier Robert - Grévin Jacques - Guillet Pernette du - Jamyn Amadis - Jodelle Etienne - La Boétie Etienne de - La Ceppède Jean de la - Labé Louise - Magny Olivier de - Malherbe François de - Marot Clément - Navarre Marguerite de - Pasquier Etienne - Régnier Mathurin - Ronsard Pierre de - Scève Maurice - Sponde Jean de - Tyard Pontus de - Urfé Honoré d' - Vauquelin de la Fresnaye Jean
17ème siècle
Benserade Isaac de - Boileau Nicolas - Chassignet Jean-Baptiste - Corneille Pierre - Deshouilères Antoinette - Gombauld Jean-Ogier de - La Fontaine Jean de - L'Hermite François Tristan - Lingendes Jean de - Malleville Claude - Marbeuf Pierre de - Maynard François - Molière (Poquelin J.-B.) - Racan H. de Bueil, seigneur de - Racine Jean - Saint-Amant M.-A. Girard de - Scarron Paul - Viau Théophile de - Vion d'Alibray Charles - Voiture Vincent
18ème siècle
Chénier André - Delille Jacques - Dorat Claude-Joseph - Ducis Jean-François - Florian Jean-Pierre Claris de - Gilbert Nicolas - Lefranc de Pompignan Jean-J. - Millevoye Charles-Hubert - Parny Evariste de - Rousseau Jean-Baptiste - Rousseau Jean-Jacques - Voltaire (F.-M. Arouet)
19ème siècle
Ackermann Louise - Allais Alphonse - Arvers Félix - Banville Théodore de - Barbey d'Aurevilly Jules - Barbier Auguste - Bataille Henry - Baudelaire Charles - Beauchemin Nérée - Bertrand Aloysius - Borel Petrus - Bouilhet Louis - Breton Jules - Cadou René-Guy - Chapman William - Chateaubriand François-René de - Coppée François - Corbière Tristan - Cros Charles - Desbordes-Valmore Marceline - Dierx Léon - Elskamp Max - Evanturel Eudore - Fabié François - Forneret Xavier - France Anatole - Fréchette Louis-Honoré - Garneau Alfred - Gautier Théophile - Gilkin Iwan - Gourmont Remy de - Guérin Charles - Heredia José Maria de - Hugo Victor - Jarry Alfred - Laforgue Jules - Lahor Jean - Lamartine Alphonse de - Lautréamont I. Ducasse, comte de - Le May Léon-Pamphile - Leconte de Lisle Charles - Lefèvre-Deumier Jules - Lenoir Joseph - Levet Henry Jean-Marie - Louÿs Pierre - Mallarmé Stéphane - Maupassant Guy de - Ménard Louis - Mendès Catulle - Mérat Albert - Merrill Stuart - Mikhaël Ephraïm - Moréas Jean - Musset Alfred de - Nelligan Emile - Nerval Gérard de - Nouveau Germain - Proust Marcel - Richepin Jean - Rimbaud Arthur - Rodenbach Georges - Rollinat Maurice - Rostand Edmond - Sainte-Beuve Charles - Samain Albert - Signoret Emmanuel - Sully Prudhomme René-François - Toulet Paul-Jean - Van Lerberghe Charles - Verhaeren Emile - Verlaine Paul - Verne Jules - Vigny Alfred de
20ème siècle
Apollinaire Guillaume - Aragon Louis - Artaud Antonin - Beauregard Alphonse - Borne Alain - Cendrars Blaise - Césaire Aimé - Char René - Claudel Paul - Couté Gaston - Desnos Robert - Duportal Marguerite - Eluard Paul - Fort Paul - Géraldy Paul - Gilkin Iwan - Jacob Max - Jammes Francis - Jouve Pierre-Jean - Lorrain Jean - Michaux Henri - Miron Gaston - Noailles Anna de - Péguy Charles - Périer Odilon-Jean - Pozzi Catherine - Prévert Jacques - Radiguet Raymond - Reverdy Pierre - Rilke Rainer Maria - Rostand Edmond - Saint-Denys Garneau Hector de - Sauvage Cécile - Segalen Victor - Sicaud Sabine - Supervielle Jules - Toulet Jean-Paul - Verhaeren Emile - Vian Boris - Vivien Renée
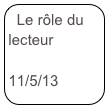
Printemps 2014